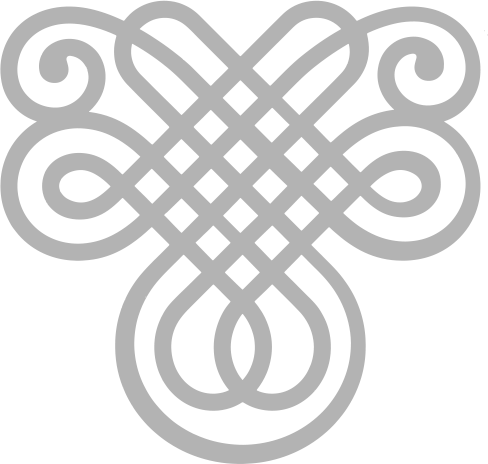RESSOURCES
Chroniques baroques
5 février 2013 - Une leçon de musique, au cinéma
Le point de départ pour notre Chronique d’Anna Magdalena Bach, c’était l’idée de tenter un film dans lequel on utiliserait la musique, ni comme accompagnement, ni non plus comme commentaire, mais comme une matière esthétique
Jean-Marie-Straub et Danièle Huillet

Dans le cadre de sa première édition, le Festival Paris-Baroque, qui s’est tenu en décembre dernier, programmait une projection du film de Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, Chronique d’Anna Magdalena Bach, réalisé en 1967. L’occasion de voir ou revoir (au moins pour la dixième fois en ce qui me concerne) une création hors du commun, peut-être le seul film à faire réellement de la musique son sujet principal. Une passionnante conversation avec Straub (Danièle Huillet est morte en 2006) prolongeait la séance.
Le cinéma de Huillet et Straub échappe à toute classification et c’est là sa force. Voulu par ses concepteurs comme un acte militant et politique, il élabore, film après film, un langage original, dépourvu d’allégeance, autonome. Cette volonté d’échapper à la normalisation constitue aussi son point faible : le financement de chaque production ne pouvant pas s’appuyer sur des perspectives de « succès » commercial, unique moteur de ce qu’est désormais le cinéma, une industrie internationale.
Le titre de l’œuvre est trompeur, car il donne à penser qu’il s’agit d’une adaptation pour l’écran du roman publié en 1930 par l’écrivain anglais Esther Meynell, La Petite Chronique d’Anna Magdalena Bach, purement fictionnel et fantaisiste, alors que le film s’appuie en réalité sur des textes d’archives contemporains de Bach.
Ce film aujourd’hui mythique témoigne d’une double rupture, cinématographique et musicale.
Jamais auparavant, la musique n’avait été filmée de cette façon. Car, bien plus que de Bach, c’est de sa musique qu’il est question, la plupart du temps de sa musique en train de se faire, dans l’instant, sous le regard de la caméra. Les musiciens jouent, chantent, travaillent, devant l’objectif qui demeure, lui, immobile. Pas de zoom, pas de travelling, aucun effet visuel. Un seul mouvement s’exprime, celui du langage musical, mais il s’avère foisonnant, irréductible. Pas de play-back, la musique est capturée en son direct, contrairement à la pratique habituelle du cinéma, qui privilégie l’image, sur laquelle on plaque ensuite un son enregistré séparément : Straub et Huillet font confiance à l’intelligence du spectateur, que l’on ne peut tromper sur la liaison entre le son entendu et le geste musical, même si le décalage semble a priori imperceptible. Surtout, les deux cinéastes font paraître à l’écran de vrais musiciens, pas des acteurs qui feignent de savoir jouer de la musique, comme lorsque Marielle et Depardieu s’efforcent de mimer grossièrement le jeu de la viole de gambe dans Tous les Matins du Monde d’Alain Corneau. Dans son Don Giovanni, Joseph Losey fait appel à de « vrais » chanteurs, notamment Ruggiero Raimondi dans le rôle-titre, mais ils se doublent eux-mêmes en post-synchronisation. Et Ingmar Bergman, lorsqu’il tourna la Flûte enchantée, dissocia purement et simplement les comédiens et les chanteurs, plaçant des voix dans des corps qui ne leur appartenaient pas.
Les producteurs de Huillet Straub étaient prêts à mettre beaucoup d’argent dans le Bachfilm, à condition que Curd Jürgens, acteur allemand alors célèbre dans le monde entier grâce à des séries B d’aventures, joue le rôle de Bach. Straub et Huillet lui ont préféré un inconnu, sans expérience ni prétention d’acteur, mais excellent musicien, Gustav Leonhardt.
C’est là que se situe la deuxième rupture. Ce choix nous semble aujourd’hui naturel : assurément, qui mieux que Leonhardt… ? La décision n’allait cependant pas de soi à un moment où la pratique sur instruments « anciens » en était à ses débuts. S’il fallait confier le rôle de Bach à un musicien, le premier vœu de la production allait plutôt vers Herbert von Karajan (!), fermement refusé par les réalisateurs, qui voulaient montrer et faire sonner la musique de Bach comme son auteur l’avait pensée et pratiquée. Bien sûr, le film est « en costumes », mais cet aspect est totalement secondaire. Ce qui importe, c’est la recherche des orgues du Nord de la République Fédérale d’Allemagne (ceux de Saxe étaient alors en République Démocratique Allemande et donc très difficilement accessibles), des orgues semblables à ceux que Bach avait pu utiliser pour accompagner ses cantates ou la Passion selon Saint Matthieu. Ce qui importe, c’est la présence d’un chœur de jeunes garçons, qui rend à la Messe en si son timbre et sa puissance incantatoire d’origine. Ce qui importe, c’est la participation de Nikolaus Harnoncourt, qui « joue » le rôle du prince d’Anhalt-Köthen sans dire un mot, mais en exécutant, avec Leonhardt, un mouvement de sonate pour viole de gambe et clavecin ; c’est la comédienne incarnant Anna Magdalena, qui déchiffre sur son épinette, non sans fautes, une pièce composée pour elle par son époux ; c’est le regard perdu de Leonhardt, dans la clarté d’une fenêtre, au moment où le spectateur entend le dernier prélude de choral pour orgue, Devant Ton trône je vais paraître…
La démarche de Straub et Huillet était tout sauf nostalgique et passéiste. Il s’agissait même, au moment de la sortie du film, d’un manifeste moderniste refusant tous les tics du cinéma commercial, au profit d’une recherche sans compromis de la vérité.
C’est sans doute cette intransigeance, cette volonté d’affirmer des choix esthétiques hors des modes, qui ont créé une estime et des liens si forts entre des cinéastes au marxisme revendiqué et l’aristocrate Leonhardt.
Ensemble, ils ont mis Bach devant nous.
(X, le 5 février 2013)
La cadence du 5e Brandebourgeois :
En savoir plus :
Une toute nouvelle édition du Bachfilm vient de paraître aux Editions Montparnasse, augmentée de nouveaux témoignages, dont celui d’Harnoncourt, et d’un livre passionnant contenant le découpage du scénario et le texte d’un entretien avec Straub et Huillet. Disponible chez l’Autre Monde.