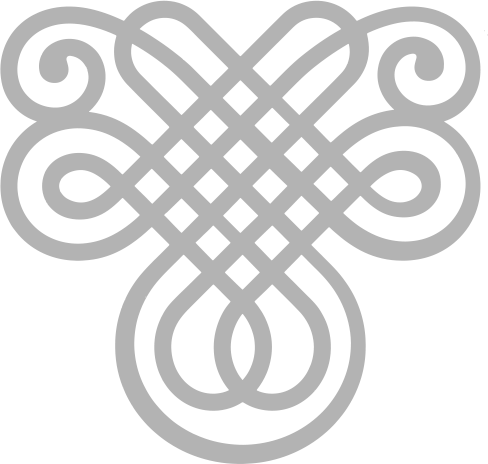RESSOURCES
Chroniques baroques
12 avril 2012 - L'illusion du savoir
Le 16 janvier 2012, Gustav Leonhardt nous quittait. Proche de l’Académie Bach depuis la création de celle-ci, il avait accepté la proposition de présider notre comité d’honneur, constitué d’artistes et personnalités du monde de la culture.
La disparition de celui qui fut l’un des initiateurs et des principaux artisans de la redécouverte de la musique ancienne depuis les années 1950 est en soi un choc émotionnel ; mais elle nous invite à essayer de comprendre ce que fut la pensée esthétique de cet homme hors du commun et de nous demander où en est aujourd’hui le mouvement qu’il a accompagné durant plus de soixante ans de vie artistique ininterrompue.
On parle souvent de Leonhardt comme d’un pionnier. Ce n’est pas complètement exact, dans le sens où d’autres avant lui, comme Arnold Dolmetsch ou Henri Casadesus, au début du vingtième siècle, avaient commencé à réfléchir à la question des musiques oubliées au fil de l’histoire et des instruments pour lesquels elles avaient été conçues. Leonhardt s’est inscrit dans cette dynamique ; incontestablement, il en a accéléré le développement, tenant une place essentielle dans l’élaboration d’une approche stylistique qui n’a cessé depuis de s’affirmer.
Lorsque le jeune musicien hollandais commence à se faire entendre, tout est à construire : peu ou pas d’instruments, peu d’instrumentistes et de chanteurs, peu de partitions, peu de concerts, peu de public… Mais quel enthousiasme ! « Même difficiles, ce furent les meilleures années… », me confia-t-il un jour. Comme d’autres artistes de sa génération, ou qui le suivirent peu après ses débuts, tels Frans Brüggen ou les frères Kuijken, Leonhardt avait dû se constituer de lui-même, par ses propres recherches, par un contact permanent, curieux et attentif avec les sources originales, une bibliothèque personnelle énorme. Celle-ci, bien que n’ayant pas vraiment de réalité matérielle, irriguait la pensée du musicien, un peu à la façon de la formule de Borges, pour qui l’Homme et la Bibliothèque ne faisaient qu’un.
Comme un iceberg, Leonhardt ne donnait à voir qu’une infime partie du savoir accumulé et assimilé au fil des années. Cette partie émergée prenait forme au moment des concerts, des cours et des enregistrements, dans l’incarnation du jeu musical, jamais (ou rarement) à travers des paroles. Leonhardt n’aimait pas beaucoup que l’on parle d’interprétation, au sens où ce terme suppose la modification, l’adaptation, d’un langage de départ vers un langage de réception – donc, partant, une inévitable trahison. Il me semble, en effet, que Leonhardt n’interprétait pas ; il mobilisait silencieusement le vaste corpus de ses connaissances, musicales mais aussi littéraires, picturales, architecturales, pour en faire le fondement de son jeu, lui-même aspirant à une sorte de transparence. Les rares textes écrits par Leonhardt (par exemple sur l’Art de la Fugue de Bach, ou sur l’histoire de sa maison d’Amsterdam) permettent de deviner l’ampleur de la part immergée de son savoir. Rien n’est laissé au hasard : ce sont les observations et les faits qui fondent le raisonnement. Je crois que cette exigence, qui était probablement aussi une méthode au sens philosophique du terme, s’appliquait à l’ensemble de son activité artistique.
Conscient de l’ampleur de ses connaissances, il ne pouvait cependant qu’en être insatisfait. Car Leonhardt évoluait aussi dans un monde frappé par des pertes, des disparitions, immenses, infiniment supérieures à ce dont nous avons gardé la trace. Perte du goût. Disparition de sources écrites, de partitions, d’instruments. Oubli de la réalité des pratiques : qu’y a-t-il vraiment derrière les mots glanés dans les traités et les témoignages anciens ? Cette conscience de ce qui échappe, de ce qui renvoie à un contact direct irrémédiablement perdu, il la résumait en quatre mots, que tous ceux qui le connaissaient lui ont entendu dire : « on ne sait pas… » Devant cela, certains spécialistes autoproclamés qui, eux, savent tout, ricanaient tout bas, ne mesurant pas que Leonhardt ne faisait pas allusion par cette formule à un vulgaire savoir conjoncturel et anecdotique, mais qu’il nous renvoyait, au delà des traités, à la question insoluble de savoir vraiment comment Bach, Frescobaldi ou Froberger pensaient et jouaient leur musique.
La perception de cette distance irréductible qui nous sépare définitivement d’un savoir exact n’a jamais empêché Leonhardt d’agir, au contraire. Mais il fallait pour cela qu’il dispose d’un concept lui permettant, la notion d’authenticité définitivement envoyée aux oubliettes, de jeter un pont entre le passé perdu et l’ignorance de notre présent. Il me semble que ce qu’il nommait « respect », comme je le lui ai souvent entendu dire, était la substance de ce pont. À cent lieues d’une posture précautionneuse qui aurait pour effet de figer la musique dans une gelée de bonnes intentions, cette forme de respect était dynamique : ne pas forcer la musique, ne pas chercher à la brusquer pour lui « faire dire » à toute force quelque chose d’original, mais d’abord la lire, en comprendre la structure et la forme, descendre au fond de sa syntaxe et de sa grammaire. Et ensuite, tout en prenant en compte le « on ne sait pas », assumer le risque de jouer. Car chaque concert était pour Leonhardt le moment d’une prise de risque absolue, ce qui lui fit toujours refuser les propositions de captations radiophoniques, qui auraient limité sa capacité d’engagement, éventualité hors de propos puisqu’il fallait tout donner, sans retenue, au public présent.
Ceci explique sans doute l’admiration qu’il éprouvait à l’égard de Blaise Pascal. Nous en avons parlé ensemble à plusieurs reprises, et je m’étonnais qu’un calviniste convaincu puisse se sentir si proche de l’auteur de L’apologie de la religion chrétienne, représentant d’un catholicisme exigeant. J’avais tort de m’étonner, car les deux hommes partageaient la même vision tragique du monde. Chez Pascal, l’humanité est livrée à elle-même et, si le divin existe, c’est sous la forme d’un Dieu caché, inaccessible par la raison. Seule la Grâce, gratuite et incompréhensible, peut sauver quelques élus, sans même que ceux-ci aient d’ailleurs obligatoirement conscience du don qu’ils ont reçu. Devant ces questions sans réponse, la seule solution est de prendre le risque du pari, pari qui ne se limite pas à un geste intellectuel, mais s’accompagne d’une joie profonde : « pleurs, pleurs de joie », témoigne le texte bouleversant du Mémorial. Pour Leonhardt, le « on ne sait pas » est de la même veine, dans la mesure où il ne renvoie pas moins à un univers inaccessible. Convaincu d’être le dépositaire d’un don tout aussi gratuit et incompréhensible, mais cependant évident, il ne considérait pas la musique comme un divertissement, peut-être même pas comme un art, mais comme une responsabilité qu’il devait assumer, et qu’il assuma jusqu’au bout, jusqu’au dernier récital un mois avant sa mort, alors qu’il était déjà épuisé par la maladie. Il lui fallait faire le pari du partage de ce don qu’il avait reçu, tout en ayant l’intime conviction que son savoir, quoique immense, ne permettait pas de façon certaine l’accès à la vérité des œuvres. Certains le considéraient hautain et froid, alors qu’il brûlait, comme Pascal, d’un feu intérieur.
Sa disparition n’est pas pour nous une fin, mais un commencement. Déjà, de jeunes musiciens suivent ses traces, avec le même enthousiasme. Il leur sera sans doute difficile de se faire entendre, car il ne faut pas se cacher que la musique ancienne est désormais devenue un élément parmi d’autres du grand manège culturel, peu favorable à l’exigence.
Mais la route est ouverte.
(IX, 12 avril 2012)